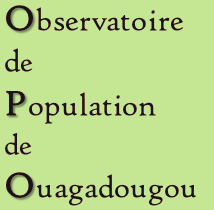L’Observatoire de Population de Ouagadougou - OPO
Variabilité climatique, conditions d'accès à l'eau et utilisation des ressources en eau dans les quartiers informels à ouagadougou, Burkina Faso
Situation du problème
Dans son rapport de 2007, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat interpelle l’opinion internationale sur le réchauffement de la planète. La température de surface au cours des 100 dernières années (1906-2005) a en effet augmenté de 0,74 °C en moyenne.
Parmi les conséquences possibles de ce réchauffement climatique, on relève pour ce qui concerne les pays du Sahel, des canicules, des sècheresses et aussi de fortes précipitations. Par exemple, durant la nuit du 24 au 25 juillet 2000, il est tombé148 mm d’eau de pluie à Bilanga dans l’Est du Burkina Faso. Puis, il a fallu attendre après trois semaines les pluies suivantes. Plus récemment, l’inondation du 1er septembre 2009 restera marquée pour longtemps dans la mémoire des citadins de Ouagadougou, tant les dégâts furent aussi énormes que surprenants : les 263 mm d’eau tombée en une demi-journée ont rasé les cases construites en périphérie de la ville, détruit des champs de cultures et occasionné des pertes en vie humaine. Au cours de la même année, des inondations dévastatrices d’ampleurs particulières se sont produites dans plusieurs pays du Sahel notamment en Mauritanie, au Niger et au Sénégal. En 2010, le même scenario s’est répété dans plusieurs localités du Burkina Faso, notamment à l’Est et au Centre Nord, ainsi qu’au Niger qui a connu une crue sans précédent du fleuve Niger.
Dans les villes du Sud, les populations des quartiers périphériques non aménagés souffrent le plus des conséquences de la variabilité climatique, en raison de l’absence d’eau courante, d’électricité, d’assainissement et de la précarité de leur habitat comme en témoigne l’exemple des quartiers pauvres de Jakarta avec les inondations de février 2007 (Texier, 2007).A Ouagadougou, la plupart des sinistrés de l’inondation du 1er septembre 2009 (plus de 20.000 ménages) étaient issus des quartiers "non lotis". Ce sont des bidonvilles situés dans les périphéries de la ville, et sont construits à base de matériaux précaires appelé banco. Ils font l’objet de peu d’attention par les pouvoirs publics en matière d’investissement en raison de leur caractère informel. En effet, investir dans ces quartiers avant leur lotissement est considéré par l’Etat comme peine perdue étant donné les chamboulements qui pourraient être occasionnés par leur future parcellarisation. Aussi faut-il noter que la commune urbaine de Ouagadougou n’a pas les moyens (financiers et techniques) pour l’équipement de la ville au rythme de son peuplement. Les quartiers "non lotis" sont donc délaissés pour compte en matière d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement. Ils ne sont couverts ni par l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) qui limite ses activités aux espaces parcellarisés, ni par les autres services du ministère en charge de l’eau, qui interviennent plutôt en milieu rural. Pourtant, c’est là que vivent de nombreux ouagalais qui ne disposent pas de moyens pour construire une maison dans les quartiers aménagés. Ils sont évalués à plus de 300000 habitants au recensement de 2006, avec une densité variant de 50 à 150 habitants par hectare. Ces "non lotis" deviennent de plus en plus nombreux du fait de la pression démographique, accentuée par l’exode rural. En effet, du fait des conséquences de la variabilité/changement climatique, de nombreux jeunes, ne pouvant plus cultiver, se voient obliger de se diriger vers la capitale pour chercher des emplois. Et pourtant, la capitale n’en dispose pas assez.
Il faut également signaler qu’en cas de sécheresse, l’accès à l’eau se complique pour les populations des quartiers informels étant donné le tarissement rapide des puits et puisards, et la baisse de la pression de l’eau courante dans les quartiers formels environnants où certaines de ces populations s’approvisionnent en eau potable. En effet, en 2000, près de 30 % des ménages vivant en zones non loties à Ouagadougou accédaient à l’eau à partir de forages et de puits et près de 55 % à partir d’une borne fontaine située dans un quartier loti proche (Dos Santos, 2006). Par ailleurs, des données issues d’une enquête réalisée dans un quartier non loti de la ville dans le cadre de la phase pilote de l’Observatoire de Ouagadougou (Pictet, 2002) a pu établir que 35% des ménages de cette zone dispose de moins de 20 litres d’eau par personne et par jour, quantité qui ne suffit pas à répondre aux besoins de base (Dos Santos, 2010a). Ce manque d’eau affecte sans doute la santé(Howard et Bartram, 2003)et la production économique (Hewett et Montgomery, 2001)d’une population qui travaille à plus de la moitié dans des activités informelles.
Comment cette frange de la population "pauvre" des villes perçoit-elle le changement climatique et ses effets ? Cette perception conditionne les réponses adaptatives en ce qui concerne l’accès à l’eau et son utilisation. Comment ces populations accèdent-elles et utilisent-elles la ressource en eau en fonction des aléas climatiques qui affectent la disponibilité et/ou la qualité de l’eau ? Cette question d’accessibilité à l’eau se pose avec acuité dans les villes africaines caractérisées par une forte urbanisation et en conséquence par une forte demande d’eau potable (Baron et Isla, 2004).
On peut également s’interroger sur les enjeux sanitaires et sociaux de l’accès à l’eau induits par les aléas climatiques. Quelles sont les conséquences sur la santé des individus, et particulièrement des enfants, des quantités et de la qualité de l’eau utilisée au sein des ménages, variables en fonction de la saison et des chocs climatiques. Existe-il des conséquences sociales, au sein des ménages, de ces variabilités de l’accès à l’eau ? Sur cette dernière question, et notamment sur les conséquences pour les femmes des difficultés d’accès à l’eau de leur ménage, la littérature théorique est relativement abondante, mais il manque de données chiffrées et précises (Rathgeber, 1996 ; Ray, 2007), et tout particulièrement en Afrique au Sud du Sahara (Dos Santos, 2010b).
| Haut | Objectifs |